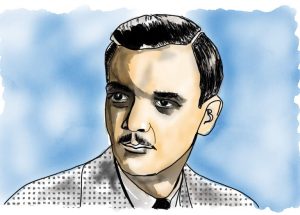 « André Laurendeau » a évoqué pendant la plus grande partie de ma vie le nom d’une polyvalente à la réputation douteuse de la Rive-Sud de Montréal1. Dans nos imaginaires d’enfants, on ne pouvait que plaindre le pauvre homme, dont on ignorait tout au-delà de l’enseigne de cette école secondaire, d’être aussi étroitement associé à un projet éducatif qui nous semblait bien peu attrayant.
« André Laurendeau » a évoqué pendant la plus grande partie de ma vie le nom d’une polyvalente à la réputation douteuse de la Rive-Sud de Montréal1. Dans nos imaginaires d’enfants, on ne pouvait que plaindre le pauvre homme, dont on ignorait tout au-delà de l’enseigne de cette école secondaire, d’être aussi étroitement associé à un projet éducatif qui nous semblait bien peu attrayant.
Léon Dion, professeur à l’Université Laval, raconte que, dès la fin des année 80, la mémoire d’André Laurendeau « paraît s’être estompée, parmi les plus jeunes tout au moins.2 » Le vingtième anniversaire de sa mort donne pourtant lieu à une série d’événements commémoratifs d’envergure comme ce colloque, tenu dans le cadre d’une série de journées annuelles sur les leaders politiques du Québec contemporain, en mars 1989 à l’UQAM, qui rassemble plusieurs dizaines d’universitaires et des conférenciers l’ayant côtoyé.
Le parcours d’un intellectuel engagé
Les actes de cet événement, qui paraissent sous le titre de André Laurendeau, un intellectuel d’ici, contiennent une bibliographie de son œuvre produite par Michel Lévesque.3 Bien que son travail bibliographique n’ait pas la prétention d’être exhaustif, Michel Lévesque affirme que les ouvrages sur André Laurendeau ne sont « pas tellement nombreux », considérant l’importance de sa contribution dans le paysage intellectuel québécois et canadien : deux biographies (celles de Denis Monière en 1983 et de Chantigny en 1984-1986), trois mémoires de maîtrise, les actes de deux colloques dont celui dans lequel cette bibliographie s’insère. Le bibliographe s’étonne en comparaison de l’intérêt que Laurendeau suscite chez les Canadiens anglais qui ont produit, entre autres, plusieurs recueils de ses articles.
VLB éditeur et Le Septentrion publient en 1990 le Journal tenu pendant la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme qu’il a présidé et dans lequel il interroge le sens et la présence du Québec au sein de la fédération canadienne.4
En 1992, Oxford University Press publie une nouvelle biographie sur Laurendeau. Rédigée par Donald J. Horton, elle s’appuie sur sa correspondance, des archives et ses journaux intimes5. La traduction paraît en 1995 chez Bellarmin avec quelques modifications concernant l’enfance de Laurendeau — qui ne se déroule pas à Outremont, comme le laisse entendre son biographe, mais plutôt sur la rue Cherrier, à Montréal où il naît le 21 mars 19126. C’est plus tard qu’il viendra s’établir avec ses parents dans l’arrondissement outremontais, d’abord rue Hutchison, puis rue Stuart, avec son épouse et ses six enfants.
En 1996, dans une collection sur les Célébrités locales (Lidec), un livret lui est consacré7. Celui-ci ramasse les principales informations biographiques connues :
- ses parents, Arthur Laurendeau et Blanche Hardy, tous les deux musiciens, appartiennent à la petite bourgeoisie canadienne-française et croient au nationalisme canadien-français;
- l’éducation puritaine qu’il reçoit, empreinte d’une religiosité passéiste et conservatrice, chez les Jésuites du Collège Ste-Marie;
- la pensée de Lionel Groulx qu’il vénère et dont il suit les cours d’histoire à l’Université de Montréal;
- le voyage d’études qu’il fait à Paris et qui infléchit sa conception de l’intellectuel et du progrès social;
- la revue L’Action nationale dont il prend la direction de 1937-1953, puis de 1948 à 1954;
- la politique active dans laquelle il s’engage au cours des années quarante, affrontant d’abord le premier ministre Mackenzie King en s’opposant à la conscription, puis Maurice Duplessis, comme chef du Bloc populaire;
- son retour au journalisme comme éditorialiste au Devoir de 1947 à 1963;
- sans oublier sa contribution à la vie culturelle — via la télévision — et littéraire — comme essayiste, romancier et dramaturge — qui connaîtra un succès mitigé. Le dernier chapitre de ce livre et de sa vie est dédié à la commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme qu’il co-préside avec Davidson Dunton.
Une mémoire vivante
La page Wikipédia sur André Laurendeau est créée en 2004 8 et fait l’objet de bonifications régulières à chaque année. Bien que le contenu de l’article dépasse le statut d’ébauche, il demeure rudimentaire. Des pages existent également dans les versions anglaise, allemande et polonaise de l’encyclopédie libre. L’élément Wikidata correspondant remonte, lui, à 2013.
En 2010, les célébrations entourant le centenaire du journal Le Devoir s’accompagnent d’une publication, sous la direction de Jean-François Nadeau, qui revisite « un siècle québécois » à travers textes et archives. Deux articles éloquents de Laurendeau y figurent. Le premier dénonce avec âpreté l’intervention politique d’un ministre dans le congédiement du peintre Paul-Émile Borduas, alors professeur à l’École du meuble et signataire du Refus global ; le deuxième concerne la suspension de Maurice Richard, hockeyeur mythique « devenu un héros national »9.
La compilation la plus récente est réalisée en 2010 par Michel Lévesque au Septentrion10. Il y est proposé d’ouvrir une fenêtre politique et une perspective historique sur le « passage de l’ère canadienne-française à l’ère québécoise. »
La parution cette année, en 2018, de la monographie Panser le Canada : Une histoire intellectuelle de la commission Laurendeau-Dunton par Valérie Lapointe-Gagnon permet de « renouer avec des personnalités qui ont joué un rôle crucial dans l’histoire québécoise et canadienne » en pratiquant une généalogie des débats intellectuels ayant présidé à l’émergence des notions de bilinguisme, de biculturalisme, de multiculturalisme, et celle qui concerne l’existence d’un statut spécial ou national pour le Québec11.
Un héritage riche d’enseignement(s)
L’arrivée dans le domaine public canadien de l’œuvre d’Andrée Laurendeau contribuera-t-elle à créer de nouvelles avenues de réflexion et des opportunités inédites pour surmonter les aléas et les caprices de la mémoire collective en redécouvrant celui qui « reste une figure exemplaire de l’intellectuel », cinquante ans après sa mort, selon les termes du journaliste du Devoir, Jean-François Nadeau, en juin dernier ? En soulignant cet anniversaire (bien tranquille jusqu’à ce jour), Nadeau suggère en outre que ses contributions sur l’éducation seraient d’une actualité stratégique12.
Il ne date pas d’hier que l’héritage de Laurendeau, en tant que critique du système éducatif et porteur d’une vision de l’enseignement national, soit célébré. Dans la dédicace du livre culte Les insolences du frère Untel adressée, en 1960, à celui qui l’avait découvert — et qui en avait aussi signé la préface — Jean-Paul Desbiens écrit : « André Laurendeau, en un certain sens, est un enseignant. J’estime qu’il a plus fait, pour instruire les Canadiens français, que la plupart des enseignants patentés. Et surtout, il a plus fait pour structurer les Canadiens français (instruire c’est structurer par l’intérieur), que la plupart des politiques. »13
Fernand Dumont, dans la préface d’un recueil d’articles publié en 1988 poursuit en ce sens : « Si Laurendeau s’est beaucoup intéressé à la politique, au point d’avoir été député et chef de parti, là n’était pas le cœur de ses préoccupations, mais plutôt le destin de la culture, plus particulièrement celui de l’enseignement.14 »
Dans la même veine, Léon Dion rappelle que Laurendeau a été le premier15 à réclamer que le nouveau gouvernement mette en place une commission royale d’enquête sur l’éducation pour ouvrir la voie du « renouvellement social.16 » Sur le plan des idées, cette préoccupation politique pour l’enseignement vise à « éduquer, participer à la formation globale de l’être et à sa culture. » comme le précise Nadine Pirotte.
Par ailleurs, cette approche s’oppose selon les propres termes de Laurendeau à « une inculture des techniciens, c’est-à-dire, des techniciens qui ne seraient que cela.17 » Ces derniers commentaires proviennent de l’un des colloques commémorant les vingt ans de sa mort et se donnant spécifiquement pour mission d’entamer de « nouveaux dialogues » avec son œuvre et ses réflexions relatives à l’éducation.18
Pédagogie sociale
Depuis la lecture des actes de ce colloque, le lien entre la figure d’André Laurendeau et l’éducation a pris une tournure définitivement plus avantageuse à mes yeux que ce que les souvenirs d’enfant que j’ai évoqués en introduction avait pavé. À l’instar de Nadine Pirotte, on peut saluer aujourd’hui le « pédagogue social » qui a accompagné pendant plusieurs décennies la transition identitaire et culturelle du Québec à travers ses activités de journaliste, de politicien et d’auteur.
Cette perspective large sur l’éducation dans la Cité défie le discours dominant actuel où la raison politique n’est plus celle du pédagogue, mais celle du gestionnaire qui se déleste de ses responsabilités en matière d’apprentissage tout au long de la vie comme priorité éducative nationale — notamment face aux enjeux de la transition numérique.
Domaine public
André Laurendeau est mort le 1er juin 1968. Son œuvre s’élève donc dans le domaine public canadien le 1er janvier 2019. Il a laissé derrière lui plusieurs livres et de nombreux articles de journaux.
Œuvres
Cette liste est loin d’être complète:
- Notre nationalisme (1939)
- L’abbé Lionel Groulx (1939)
- Actualité de Saint-François (1938)
- Alerte aux Canadiens français! (1941)
- Nos écoles enseignent-elles la haine de l’anglais? (1942)
- Ce que nous sommes (1945)
- La centralisation et la guerre (1948)
- La vertu des chattes, théâtre (1959)
- Voyages au pays de l’enfance (1960)
- Deux femmes terribles, théâtre (1961)
- La crise de la conscription 1942 (1962)
- Le Canada, une nation ou deux (1962)
- Condamnés à vivre ensemble (1963)
- Marie-Emma, théâtre (1963).
- Une vie d’enfer, roman (1965)
- Pour une enquête sur le bilinguisme (1967)
Archives
Les archives d’André Laurendeau sont conservées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec :
- « Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Fonds Familles Laurendeau et Perrault (CLG2) »
- « Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Fonds Ligue pour la défense du Canada – 1939-1943 (CLG6) »
Sources et références
- Wikipédia (fr): André Laurendeau
- Wikipédia (en): André Laurendeau
- Wikipédia (de) : André Laurendeau
- Wikipédia (pl) : André Laurendeau
- Chantigny. L. (mars 1984). André Laurendeau, journaliste, ou l’incandescence du givre. L’incunable. Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec, p. 7-15.
- Chantigny. L. (mars 1984). André Laurendeau à Paris ou le statut de l’intellectuel. L’incunable. Bulletin de la Bibliothèque nationale du Québec, p. 10-18.
- Monière. D. (1983). André Laurendeau et le destin d’un peuple. Montréal : Québec-Amérique. 347 p.
Notes et liens complémentaires
- École secondaire André Laurendeau. [consulté le 27 déc. 2018]
- Dion. L. (1989). Bribes de souvenirs d’André Laurendeau. Dans N. Pirotte (dir.), Penser l’éducation, p. 38. Montréal : Éditions du Boréal.
- Lévesque, M. (1990). Bibliographie. Dans R. Comeau et L. Beaudry (dir.), André Laurendeau, un intellectuel d’ici, pp. 291-298. Sillery, Québec : Presses de l’Université du Québec.
- Laurendeau, André. Journal tenu pendant la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Outremont : VLB Éditeur.
- Horton. D. J. (1992). André Laurendeau French Canadian Nationalist. Don Mills : Oxford University Press.
- Horton. D. J. (1995). André Laurendeau : La vie d’un nationaliste 1912-1968 (traduit par M. Pelletier). Bellarmin.
- Bouvier. F. (1996). André Laurendeau. Célébrités / Collection biographique.
- Wikipedia (fr): André Laurendeau : Historique des versions
- Nadeau. J.-F. (2010). Le Devoir : un siècle québécois. Montréal : Les Éditions de l’homme, p. 104 et 126.
- Lévesque. Michel (2010), À la hache et au scalpel : 70 éditoriaux pour comprendre Le Devoir sous Gérard Filion (1947-1963) [et André Laurendeau]. Québec : Septentrion.
- Lapointe-Gagnon. V. (2018). Panser le Canada : Une histoire intellectuelle de la commission Laurendeau-Dunton. Montréal : Les Éditions du Boréal.
- Nadeau. J.-F. (1er juin 2018). « Cinquante ans après sa mort, André Laurendeau reste une figure exemplaire de l’intellectuel ». Le Devoir. [lire en ligne]
- Auteur anonyme (André Desbiens). (1960, 1988). Les insolences du frère Untel. Préface de André Laurendeau. Montréal : Les Éditions de l’homme, p. 12.
- Dumont, F. (1988). Préface. Dans S. Laurin (dir.), André Laurendeau, artisan des passages. Montréal : HMH.
- Le 15 novembre 1960, quelques mois après élection de Jean Lesage.
- Dion. L. (1989). Bribes de souvenirs d’André Laurendeau. Dans N. Pirotte (dir.), Penser l’éducation, p. 39. Montréal : Éditions du Boréal.
- Laurendeau. A. (1970). Ces choses qui nous arrivent. Chronique des années 1961-1966. Montréal : Hurtubise HMH (Coll. Aujourd’hui), p.300.
- Pirotte. N. (dir.). (1989). Penser l’éducation, Montréal : Éditions du Boréal.